Il arrive parfois que l’amour devienne un champ de mines : chaque silence, chaque absence, chaque faille dans la complicité devient un tremblement possible, une insécurité affective permanente. Si vous avez peur d’être abandonné.e, votre relation – plutôt que d’être un espace d’échange serein et de croissance – devient un terrain où il faut sans cesse vous rattraper, anticiper, se prémunir…. Bref : tout faire pour ne pas être abandonné.e. Dans cet article je vais vous donner des pistes pour moins souffrir de cette peur.
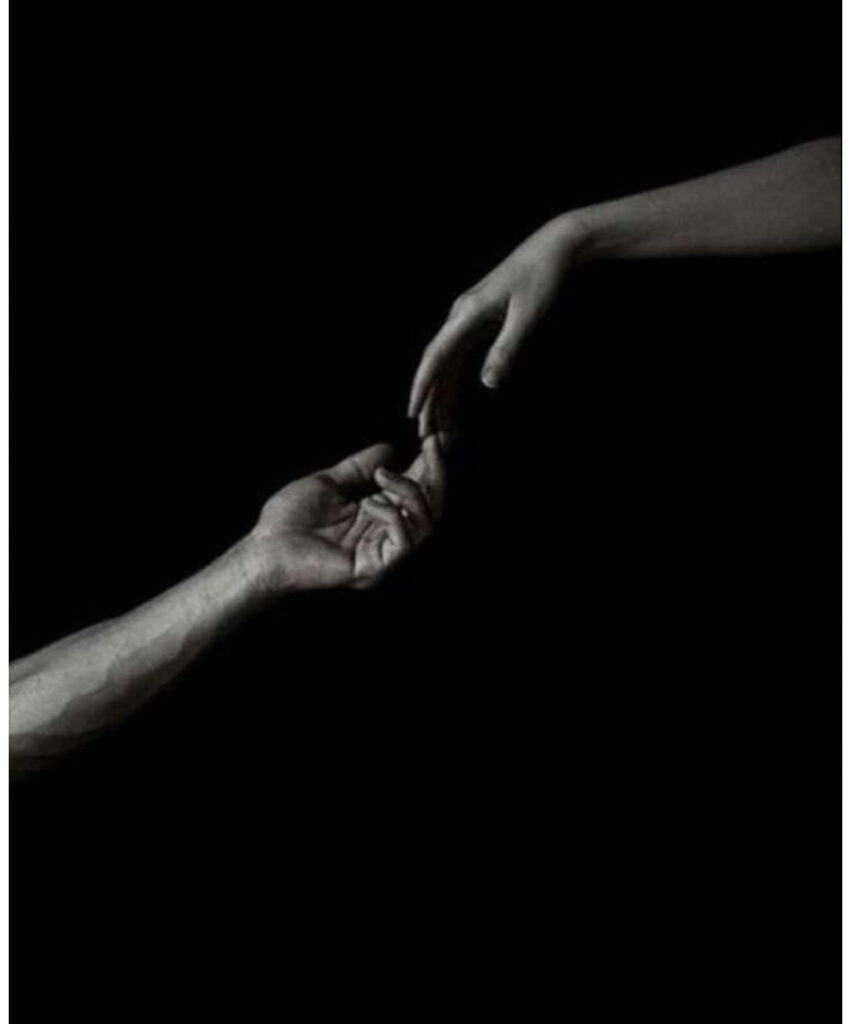
D’où vient cette peur d’être abandonné, quitté ?
La peur de l’abandon ne vient pas de nulle part. Elle s’installe dans l’enfance, souvent de façon subtile : un parent émotionnellement absent, des soins donnés sous condition, des signaux d’amour retournés quand l’enfant n’obéit pas, ou encore un environnement où l’attachement se fait et se défait selon des comportements imprévisibles. Cela crée un attachement insécurisant : l’enfant apprend que l’amour peut être retiré, que la présence peut disparaître sans raison apparente.
Ce pattern, s’il n’est pas réparé, se transpose à l’âge adulte : la relation amoureuse réveille non seulement le partenaire d’aujourd’hui, mais aussi ce parent « absent », ce lien rompu, cette peur de fond.
Dans cette logique, chaque distance — qu’elle soit réelle ou imaginaire — active l’ancienne blessure : « il/elle partira », « je ne mérite pas d’être aimé·e », « je suis seul·e après tout ». C’est un drame silencieux, car souvent invisible aux yeux de l’autre, mais très réel pour celui ou celle qui le vit.
Les réflexes typiques du peureux de l’abandon
Voici ce que l’on observe fréquemment chez quelqu’un qui porte cette peur de l’abandon :
- Hypervigilance : Il ou elle capte le moindre changement de ton, de retard, de retrait. L’autre repousse un peu, se tait, et tout s’ouvre comme une faille. Le peureux interprète, anticipe, teste.
- Besoin constant de réassurance : « Tu m’aimes toujours ? Tu restes ? » devient moins une question qu’un rituel. L’amour se mesure à la preuve d’amour.
- Sur-adaptation ou fusion : Pour ne pas être abandonné·e, on s’efface. On devient indispensable, on anticipe l’autre, on renonce à ses propres désirs, par peur que leur expression ne provoque un rejet.
- Sabotage anticipé : Paradoxalement, quand la relation commence à être profonde, stable, le peureux peut précipiter la rupture — mieux vaut partir que d’être abandonné. Mieux vaut contrôler la fin que subir l’inconnu.
- Impossibilité d’être seul·e ou en suspension : L’ « absence » ou la distance n’est pas tolérée comme une respiration, mais vécue comme une menace directe.
- Le conflit-tabou : L’idée que « si je dis ce qui me dérange, je risque de le perdre ». Alors on se tait, on compense, on intériorise. Le problème ne disparaît pas pour autant, il s’aggrave.
Ce sont des réflexes de survie : ils ont été nécessaires à un moment de la vie. Mais à l’âge adulte, dans une relation d’égal à égal, ils deviennent des obstacles. Le peureux ne vit pas la relation comme un lieu de sécurité mais comme une vigilance permanente.
Comment vivre une relation avec cette peur d’être abandonné ?
Fixons-nous trois axes pratiques : intérieur, relationnel, somatique. Trois niveaux d’intervention qui, ensemble, peuvent transformer la peur d’abandon en conscience, et la conscience en mouvement vers une meilleure relation.
1. Travail intérieur : reconnaître ce qui se rejoue
- Prendre conscience : Ressentir la peur, la nommer (« Je sens ma peur d’être abandonné·e qui monte ») lui ôte déjà une grande partie de son pouvoir.
- Retracer l’origine : Quel parent, quelle figure, quelle situation a appris à votre cerveau que l’amour n’était pas sûr ? Identifier l’ancrage permet de dédramatiser la réaction actuelle.
- Se responsabiliser sans se culpabiliser : Ce n’est pas « ma faute », mais « voici ce qui se vit en moi» et «je choisis d’agir dessus».
- Nourrir sa valeur propre : Le cœur de la peur n’est pas l’autre, mais «et si je ne suis pas assez ?». Le travail est donc de renforcer la conviction ; «je suis digne d’amour, même quand il n’y a pas de preuve immédiate».
2. Dans le couple : construire une alliance sécurisante
- Communication transparente : Dire au partenaire : «Quand tu es silencieux, je ressens la peur d’abandon. Cela ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance, juste que ce qui est vieux se réactive».
- Convenir de règles rassurantes entre vous et votre partenaire : petits rituels, régularité d’échanges, prévisibilité qui rassurent le système émotionnel du peureux.
- Apprendre à tolérer la distance : La relation durable inclut des phases d’absence, de retrait ou de recentrage. Il ne faut pas que chacune soit vécue comme une ruine. Le travail est d’envisager que l’amour reste présent même quand le partenaire n’est pas immédiatement visible.
- S’affirmer sereinement : Le peureux doit pouvoir poser ses besoins sans ressentir qu’il est en train de déclencher la fin. Le partenaire doit accueillir cette vulnérabilité sans que cela devienne un outil de manipulation (« Je fais ça pour que tu restes ») mais un partage honnête.
« Le travail d’un peureux de l’abandon est d’envisager et de comprendre que l’amour reste présent même quand le partenaire n’est pas là ou immédiatement visible. »
Agnès Love Coach
3. Somatique et rythmes de vie : apprendre au corps que tout n’est pas danger
- Travail de régulation : Respiration, méditation, relâchement, ancrage corporel, hypnose. Le système nerveux du peureux est souvent en alerte : il faut lui apprendre que l’alerte n’est pas systématiquement justifiée.
- Activité ressource : Se reconnecter à des activités qui ne dépendent pas de l’autre, pour apprendre à être « assez » seul·e.
- Thérapie ou accompagnement ciblé : La peur d’abandon a souvent des racines anciennes. Une psychanalyse, une thérapie d’attachement ou une approche somatique peut être indispensable.
- Patience et persévérance : Le cerveau change lentement, les réflexes anciens ne s’effacent pas en un jour. Mais chaque petit pas compte.
Et si on transformait cette peur ?
Parce que, finalement, la peur d’abandon, si elle est reconnue, peut devenir un allié. Elle signale une blessure, oui, mais elle témoigne aussi d’un désir de lien, d’une intensité d’amour qui ne veut pas s’éteindre. Le travail n’est pas d’annuler la peur, de faire comme si elle n’existait pas, mais de l’accueillir, de l’écouter, de la mettre en lumière. Le jour où la personne peureuse réalise que l’amour n’est pas une promesse d’éternité, mais un mouvement libre entre deux êtres autonomes, elle cesse de s’épuiser à retenir… et commence à vivre. Elle cesse de se battre pour ne pas être quittée, et commence à recevoir.
Pour conclure
Avoir peur de l’abandon ne signifie pas « ne jamais aimer tranquille ». Au contraire, c’est un appel à aimer plus consciemment, à donner non pas par peur d’être abandonné ou rejeté mais par liberté, à dialoguer non pas par panique mais par présence. C’est le seul chemin qui permet d’aimer sereinement.
Si vous désirez être accompagné sur ce chemin, prenons rendez-vous !


